Une soirée passionnante s’est déroulée aux archives départementales d’Ille-et-Vilaine en décembre dernier avec la projection du documentaire « Théret n°487 », en présence du réalisateur Julien Hillion. Ce film raconte l’authentique et douloureuse histoire de François-Henri Théret, gavroche né à Paris à la fin du XIXe siècle. Miséreux, livré à lui-même, plusieurs passages devant le tribunal correctionnel finiront par le conduire à la maison de correction de Belle-Île-en-Mer où il vivra les pires traitements. Au-delà de ce récit poignant, nous avons eu envie d’en savoir plus sur l’aide apportée par les archives départementales du Morbihan qui, avec le ministère de la Justice et la Région Bretagne, ont été un réel soutien au projet. Après un mail envoyé au service communication, de fil en aiguille, nous nous sommes retrouvé un après-midi au téléphone avec Marion Humbert, cheffe du service aux archives départementales du Morbihan, et Marie Géraud, archiviste chargée notamment des archives judiciaires et hospitalières.
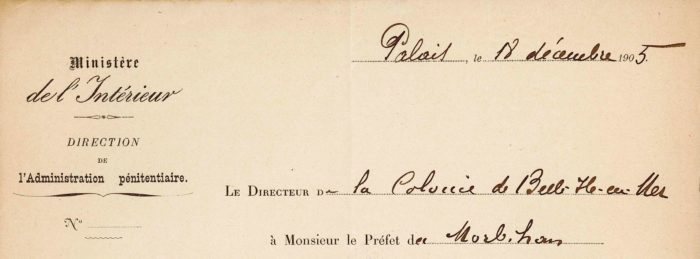
[ALTER1FO] : Marion Humbert, vous êtes cheffe du service des archives départementales du Morbihan et conservatrice du patrimoine. Quel est le rôle d’un·e archiviste aujourd’hui ?
[Marion Humbert] : Le métier d’archiviste ne se résume pas à une seule fonction. Il englobe plusieurs spécialités et missions, mais on peut les synthétiser en quatre grands axes, souvent regroupés sous l’acronyme des « quatre C ».
D’abord, collecter : il s’agit de faire entrer des documents, qu’ils soient papier ou numériques, dans le service des archives. Ensuite, classer : ces documents arrivent souvent dans un certain désordre, il faut donc les organiser selon des standards et normes reconnues pour garantir leur accessibilité. Troisièmement, conserver : si un document se dégrade à cause de l’humidité ou qu’un fichier numérique devient obsolète et impossible à ouvrir, il perd toute utilité. Enfin, communiquer : rendre ces archives accessibles au public, les mettre en valeur et aider les chercheuses et chercheurs à les exploiter.
Quelles sont les compétences essentielles pour exercer ce métier ?
Cela dépend du domaine d’activité de l’archiviste. Par exemple, une personne qui se spécialise dans le classement doit faire preuve de rigueur et de patience, car certaines archives, notamment fiscales, peuvent être rébarbatives ou un peu austères. En revanche, pour l’accompagnement du public, il faut un bon sens du contact et une certaine discrétion afin d’accueillir les usager·ères dans les meilleures conditions. Enfin, celles et ceux qui se consacrent à la mise en valeur des archives, notamment via l’organisation d’expositions, d’événements ou des interventions scolaires, doivent avoir une excellente expression orale et une approche pédagogique adaptée à leur audience. Finalement, l’archiviste n’est donc pas seulement un·e simple gestionnaire de documents, c’est avant tout un rôle de médiateur, conseiller et parfois enseignant.
L’importance du service joue-t-elle sur les missions des archivistes ?
Oui, absolument. Dans un service comme celui du Morbihan, qui compte une quarantaine de personnes, dont à peu près une vingtaine d’archivistes, la spécialisation est plus marquée. Certain·es sont exclusivement chargé·es du classement dans leur domaine de prédilection. En revanche, dans des services plus petits, les archivistes doivent être plus polyvalent·es et savoir jongler entre le classement, le conseil en gestion documentaire et l’accueil du public.
Quels types de documents traitez-vous majoritairement dans votre département ?
Nous nous occupons principalement des archives contemporaines, c’est-à-dire postérieures à 1940. Toutefois, nous avons des documents de toutes les époques : le plus ancien date du douzième siècle, de 1108 ! Grâce à une équipe compétente et diversifiée, nous couvrons un large spectre de collectes documentaires, qu’il s’agisse de documents de justice, d’archives communales, de livres, d’archives privées ou de domaines plus particuliers au département du Morbihan : administration des Phares et Balises, groupements de vulgarisation agricole.
Comment qualifiez-vous les conditions de travail aux archives départementales du Morbihan ?
Honnêtement, nous avons de la chance. Ayant travaillé ailleurs, je peux dire que le Morbihan bénéficie d’un bel environnement de travail. Notre bâtiment est moderne et fonctionnel, et nous venons d’inaugurer une extension pour faire face à la croissance constante des archives dans de bonnes conditions.
Quelles sont alors les principales difficultés rencontrées ?
Le principal obstacle vient plutôt d’une méconnaissance de l’importance des archives, tant dans le secteur public que privé. Beaucoup ignorent les obligations réglementaires liées à la gestion des archives publiques, ce qui peut entraîner des oublis ou des erreurs. Nous avons donc un rôle essentiel de sensibilisation, mais cette mission est parfois fastidieuse. Les administrations connaissent un turn-over important, et chaque nouvelle recrue doit être formée de nouveau.
Côté archives privées, nous rencontrons des passionné·es de patrimoine, mais aussi parfois par hasard des documents conservés malheureusement dans de mauvaises conditions. Cependant, lorsqu’on leur explique la valeur de ces documents, les réactions sont très positives. La conservation du patrimoine est une cause qui parle à beaucoup de gens.
Pour rebondir à votre propos, peu de personnes savent que les archives sont ouvertes à tout le monde, et pas uniquement aux chercheuses et chercheuses, journalistes ou historien·nes. Est-ce aussi votre sentiment ?
Nous disposons d’un site internet où de nombreuses archives sont consultables directement en ligne. Les statistiques montrent que de plus en plus de personnes adoptent ce réflexe. Cependant, lorsqu’on expose des documents lors des Journées du Patrimoine, par exemple, les visiteurs et visiteuses nous demandent souvent s’ils et elles ont le droit de les consulter. La réponse est bien évidemment, oui !
Sous réserve de leur état de conservation et des règles de confidentialité, les archives publiques sont accessibles à toutes et tous. Il est bon de le répéter, cela peut sembler intimidant au premier abord ! Aux archives, les documents font partie du patrimoine commun et chacun·e a le droit d’y avoir accès.
Tous les documents historiques sont-ils librement accessibles ?
Non, et c’est un point important. Les documents relatifs à l’enfance délinquante ou en danger sont soumis à des délais de communicabilité qui varient entre 50 et 100 ans après la conclusion du dossier. Dans le cadre du documentaire de Julien, cela concernait des personnes ayant vécu au XIXe et au début du XXe siècle, donc les documents étaient accessibles. Mais pour des dossiers plus récents, les restrictions sont strictes afin de protéger la vie privée des individus concernés.
Merci beaucoup Marion Humbert !
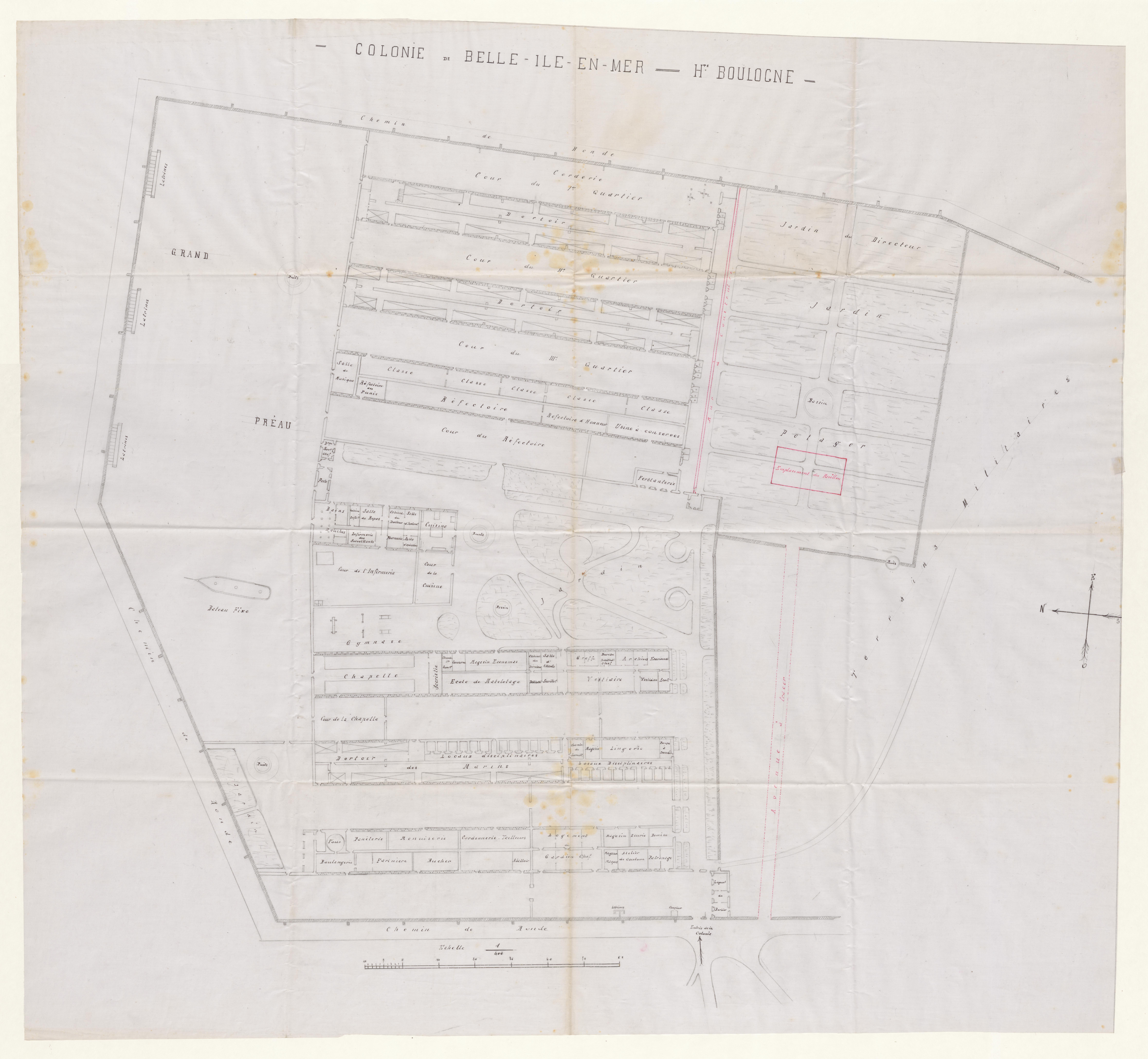
[ALTER1FO] : Archiviste aux Archives départementales du Morbihan, spécialiste des archives judiciaires et pénitentiaires, Marie Géraud, comment décririez-vous votre travail ?
[Marie Géraud] : Mon travail consiste principalement à collecter et à classer les documents. J’interviens également, mais dans une moindre mesure, sur leur conservation et leur communication au public.
En collaboration avec Julien Hillion que nous avons présenté au début de cet article, vous avez travaillé sur un fonds d’archives relatif à la colonie pénitentiaire agricole et maritime de Belle-Île-en-Mer, un établissement public créé par décision ministérielle du 29 mai 1880 dans les bâtiments de l’ancienne prison de Haute-Boulogne jouxtant la citadelle. Est-ce que l’histoire de ce lieu était déjà connue par les archives départementales ?
Nous savions que nous disposions d’un fond traitant de ce sujet, ce n’était pas une découverte à proprement parler. Localement, ce fond a toujours « intéressé », et a permis à quelques historien·nes d’écrire quelques articles sur le sujet. Mais Julien Hillion est le premier universitaire à en avoir fait son sujet d’étude. Il a commencé ses recherches en 2005 dans le cadre de sa maîtrise.
Comment accompagnez-vous les personnes dans leurs travaux ?
Toute personne qui souhaite consulter des archives est accueillie en salle de lecture, où un·e président·e de salle les oriente en fonction de leur sujet de recherche. Lorsqu’un·e archiviste a travaillé sur le classement d’un fonds, il peut être amené à apporter des compléments d’information aux chercheuses et chercheurs. Cela fait partie de notre mission d’accompagnement.
Comment s’est déroulé votre travail ou collaboration avec Julien sur ce fonds d’archives ?
Julien avait déjà une grande connaissance du fonds avant son classement, car ses recherches avaient commencé dès 2005. Mon travail de classement est intervenu bien plus tard, en 2019-2020. Il m’a contacté pour savoir si j’avais trouvé des documents qu’il aurait pu manquer. Nous avons beaucoup échangé à ce sujet et, lorsqu’il a commencé ses recherches pour son documentaire, j’ai affiné ses pistes pour être certaine qu’aucune source ne lui échappe.
Quelles ont été les principales difficultés rencontrées pour ces recherches ?
Comme Julien Hillion l’explique bien son documentaire, les archives de la colonie ont brûlé en 1959. Les documents que nous avons aujourd’hui proviennent principalement des fonds de la préfecture, ce qui signifie qu’ils sont partiels et parfois incomplets. Enfin, aux archives départementales du Morbihan, nous conservons 34 kilomètres linéaires de documents. Il est donc difficile de garantir une recherche exhaustive à un instant T. Toutefois, le ou la président·e de salle de lecture et l’expérience des archivistes aident à optimiser les recherches.
Ce nombre de 34 kilomètres est impressionnant, c’est presque la distance entre Rennes et Combourg pour se donner un ordre d’idée. Tous les fonds d’archives sont-ils classés et accessibles ?
Non, certains documents ne sont pas encore entièrement classés. Nous avons environ 30 kilomètres d’archives déjà identifiés dans un premier temps et environ 4 kilomètres qui n’ont pas encore fait l’objet d’un classement définitif. Cela ne signifie pas qu’ils sont inconnus, mais qu’ils n’ont pas encore été totalement répertoriés.
Quel regard portez-vous sur la mise en valeur des archives à travers des documentaires comme celui de Julien ?
Nous sommes très favorables à toute mise en valeur de notre travail. Les archives souffrent parfois d’un manque de reconnaissance. Un documentaire comme celui-ci permet de montrer l’importance des sources « primaires ». D’ailleurs, ce sont bien les archives qui sont mises en avant, pas les archivistes, et c’est ce qui m’a particulièrement plu.
Merci beaucoup Marie Géraud !
- Propos recueillis par Polly, le 03/02/2025.
- Crédit Illustration, carte postale : Archives départementales du Morbihan, 9Fi152/11

« Théret n° 487 » éclaire l’histoire oubliée de la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer

Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à nos archives et de la rigueur dont vous avez fait preuve dans votre travail journalistique.