À l’invitation de la librairie Le Failler, Caroline Darian1, autrice et fondatrice de l’association « M’endors pas », est venue livrer un témoignage à la fois bouleversant et nécessaire. Fille de Gisèle Pélicot, victime de plus de deux cents viols par soumission chimique, et de Dominique Pélicot, bourreau-violeur en série aujourd’hui condamné, Caroline Darian signe Pour que l’on se souvienne (Éditions JC Lattès), un livre-choc qui retrace les étapes d’un procès hors norme qui s’est tenu à Avignon à la fin de l’année 2024, et dont les révélations glaçantes ont profondément ému et bousculé l’opinion nationale et internationale.
Mais au-delà du récit judiciaire, c’est une autre vérité que l’autrice cherche à faire entendre : celle d’une justice vacillante, lente à reconnaître toutes les victimes, prompte à les invisibiliser. En racontant sa propre histoire, à la fois témoin, partie civile et victime, Caroline Darian interroge la capacité des institutions à nommer les violences, et à lui opposer une réponse digne.
Pendant près d’une heure, la salle, presque exclusivement féminine (les hommes étaient, une fois encore, peu représentés, NDLR) a écouté avec gravité une parole rare, posée, sans détours. Un moment suspendu, où la force des mots a su dire ce que la société, même 8 ans après la déflagration salvatrice #MeToo, peine encore à entendre. Nous y étions. Voici notre compte-rendu.

« Un procès historique mais incomplet »
Le procès dit « des viols de Mazan », sans doute l’un des plus saisissants de ces dernières années, n’aura duré que 109 jours. Moins de quatre mois pour juger 51 hommes, dont Dominique Pélicot, accusé principal. Une temporalité que déplore Caroline Darian. « L’instruction a été trop rapide », estime-t-elle aujourd’hui, regrettant qu’une part importante de la vérité soit restée dans l’ombre. À ses yeux, le procès n’a mis en lumière que la partie émergée de l’iceberg : « Pour les faits commis à l’encontre de ma mère, et pour les photographies retrouvées dans son ordinateur », dit-elle avec gravité.
Une critique partagée jusque dans les rangs judiciaires. Lors de son audition à la barre le 8 novembre dernier, la juge d’instruction Gwenola Journot a reconnu que l’enquête aurait pu se poursuivre pendant « plusieurs années », tant les éléments non élucidés demeurent nombreux. D’ailleurs, la fille de Gisèle Pelicot n’hésite pas à évoquer cette tentative de viol de 1999 en Seine-et-Marne que son géniteur (sic) a pourtant reconnu, et qui n’a jamais été intégrée à l’affaire actuelle. « On ne sait toujours pas quand tout a commencé, ni combien de victimes il y a vraiment eu, ni combien d’hommes se sont rendus au domicile conjugal. Ce détail reste toujours inconnu. »
« Un procès sous tension »
Au-delà de la douleur des faits, le procès a aussi exposé les failles d’un dispositif judiciaire inadapté. Caroline Darian revient sur une atmosphère d’audience marquée par une violence palpable, presque physique « Nous étions contraint·es à une cohabitation quotidienne avec les accusés. Nous nous croisions régulièrement… dans les couloirs, aux pauses café, pour aller aux toilettes. » Une proximité imposée, presque irréelle, amplifiée par une audience publique rendue possible uniquement par la volonté de Gisèle Pelicot de lever le huis clos. Une décision prise seulement quelques mois avant l’ouverture du procès. « Et jamais, ma mère n’a regretté ce choix. »
Violence verbale, aussi. Caroline Darian pointe l’attitude de certain·es magistrat·es, et leur réticence à nommer clairement les actes jugés. « J’ai constaté que certains magistrats préféraient parler de “relations sexuelles non consenties” plutôt que de viol. Cette réticence à employer les mots justes révèle à quel point il reste du chemin à parcourir, notamment en matière de formation. » Une dérive sémantique qui a nourri un sentiment de malaise persistant, renforcé par l’attitude de nombreux accusés, « qui ont refusé de reconnaître les faits, ou ont cherché à en minimiser la gravité ».
La défense n’est pas épargnée. Et pour cause. Caroline Darian évoque, sans détour, le comportement de Me Nadia El Bouroumi, avocate de deux accusés. Elle lui reproche d’avoir transgressé la solennité de l’audience en s’exposant de manière déplacée sur les réseaux sociaux. « Elle s’est improvisée grande influenceuse, sans le moindre respect pour l’histoire de ma mère. » Une référence notamment à une vidéo publiée sur Instagram, dans laquelle l’avocate dansait sur la chanson Wake Me Up Before You Go Go — une scène qui avait suscité une vive polémique à l’époque. Autre cible mais évoquée cette fois-ci dans son livre : Me Christophe Bruschi, avocat de la défense, qui a tenu des propos méprisants à l’encontre des soutiens de Gisèle Pélicot, les qualifiant de « hystériques », de « mal embouchées », ou encore de « tricoteuses ».
« Une prise de parole brève, une reconnaissance limitée »
Pour Caroline Darian, le procès des viols de Mazan ne représente pas un aboutissement, ni une fin en soi. Plutôt une étape, lourde mais nécessaire, sur le chemin de la vérité. « Oui, j’attendais des réponses. Mais pas uniquement pour moi. » C’est dans cet esprit qu’elle a choisi d’écrire Pour que l’on se souvienne, un récit personnel mais résolument tourné vers les autres.
Lors de son passage à la barre, son témoignage n’a duré qu’une vingtaine de minutes — une brève prise de parole, intervenue juste avant la pause-déjeuner. Une temporalité qui contraste avec les années de douleur et d’attente qu’elle portait. Trop court, trop condensé : un moment qui, selon elle, n’a pas permis à la justice de véritablement entendre sa voix. « J’ai vu des magistrats visiblement désemparés, dépassés par ma détresse. J’en ai même vu un pleurer », confie-t-elle. Mais cette émotion, aussi sincère fût-elle, n’a débouché sur aucune reconnaissance concrète.
Le constat est donc amer. À l’impact du traumatisme initial, Caroline Darian ajoute aujourd’hui la douleur d’un silence judiciaire persistant. « Après cela, j’ai eu un sentiment de frustration, comme si mon cas n’intéressait pas la cour. » En cause, selon elle, une mauvaise qualification des faits dès le dépôt de plainte, réduits à une atteinte à l’intimité, bien loin de ce qu’elle considère comme le cœur même de l’affaire. « Dominique a joué avec le temps, a contourné la vérité et je n’ai pas obtenu toutes les réponses que j’espérais. »
Tout au long du procès, Dominique Pélicot a nié les faits. Il a affirmé n’avoir « jamais touché » sa fille, variant les versions jusqu’à prétendre « ne pas se souvenir » de photos pourtant accablantes. Face à lui, Caroline Darian a tenu bon. « Garder son calme face à son propre père, en sachant ce qu’il vous a fait, tout en le voyant nier ou contourner la vérité, c’est extrêmement difficile. J’espérais repartir avec des éléments qui m’auraient permis de me reconstruire. Mais je n’y suis pas parvenue. Ce face-à-face a confirmé l’image d’un prédateur sexuel. Aujourd’hui, il est clair pour moi qu’il est irrécupérable et représente un danger pour la société. » Une parole forte, posée, et sans illusion. Dans la salle, un silence attentif.

« Un combat judiciaire qui se poursuit »
Le verdict rendu à Avignon n’a pas clos l’histoire. Pour Caroline Darian, le combat continue. « Certaine d’être aussi la victime » de Dominique Pélicot, une nouvelle plainte a été déposée auprès du parquet de Versailles faisant état de plusieurs chefs d’accusation : viol, tentative de viol, agression sexuelle commise par un ascendant, administration de substances destinées à altérer le discernement dans le but de commettre une agression sexuelle. « L’une des photos où l’on me voit dénudée et sous sédation a été prise chez moi, dans ma propre maison. C’est pour cette raison que j’ai déposé plainte auprès du parquet de Versailles. Il revient maintenant au procureur de la République de décider s’il ouvre une nouvelle enquête ou si l’affaire est classée sans suite. »
Au-delà de l’arène judiciaire, Caroline Darian poursuit un engagement de chaque instant. À travers son association « M’endors pas », elle accompagne et recueille les paroles de celles et ceux qui, comme elle, peinent à faire entendre leur vérité. « Il y a encore tant à faire. Tant de victimes, partout en France, qui se battent dans le silence. Il n’y a pas que des femmes : des hommes aussi, et de nombreux enfants victimes d’inceste, sont drogué·es à leur insu par un proche. » Les témoignages affluent, bruts, douloureux. Ils disent la violence sourde d’un phénomène encore mal reconnu, celui de la soumission chimique — souvent sans trace, sans preuve, sans recours. « Je représente les 99 % des victimes en France qui savent ce qui s’est passé mais qui ne peuvent prouver l’horreur vécue. », souligne-t-elle.
Un cri d’alerte, lancé à la justice, mais aussi à la société tout entière. À travers son livre, ses prises de parole, son activisme, Caroline Darian appelle à une réforme en profondeur des mécanismes de reconnaissance judiciaire. Pour que d’autres voix, longtemps ignorées, puissent enfin être entendues.
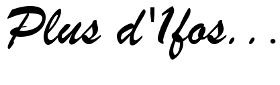

1 : « Darian » est un nom d’emprunt, formé à partir des prénoms de ses deux frères, David et Florian.
