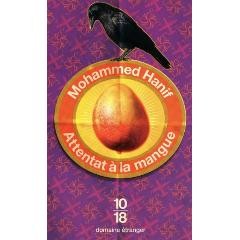 En 1988, au Pakistan, l’avion transportant le Général Zia-ul-Haq s’écrasa dans des circonstances non élucidées. Il était accompagné de plusieurs membres de son état-major ainsi que de l’ambassadeur des États-Unis.
En 1988, au Pakistan, l’avion transportant le Général Zia-ul-Haq s’écrasa dans des circonstances non élucidées. Il était accompagné de plusieurs membres de son état-major ainsi que de l’ambassadeur des États-Unis.
Depuis 1977, il dirigeait le pays, après avoir imposé la loi martiale et fait pendre l’ancien premier ministre, Ali Bhutto.
Le roman de Mohammed Hanif commence par le crash. Quelques pages plus loin, l’un des personnages demande l’intérêt d’une histoire dont on connait le dénouement, son compagnon lui répond qu’il s’agit de savoir ce qui s’est passé pour en arriver là.
Nous suivons donc les aventures du sous-officier aspirant Ali Shigri, mis aux arrêts suite à la disparition de son camarade de chambrée, Obaid-ul-llah. En parallèle, le récit alterne avec les tribulations du Général Zia, président de 130 millions de musulmans.
Tout cela est à la fois tragique et comique. Le jeune soldat a pour moteur principal les sentiments qui le bouffent suite à la découverte de son père, pendu. Enfermé dans des chiottes puis dans le noir à côté du secrétaire général du Syndicat des balayeurs du Pakistan, Ali a l’humour qui convient à sa situation.
« Le soldat ne me met pas le bandeau sur les yeux. Il m’emmène dans une pièce qui s’évertue à ressembler à une salle de torture. Un fauteuil de coiffeur muni de sangles en caoutchouc sur les accoudoirs est relié à un système électrique amateur. Sur une table est disposé un assortiment de cannes, de fouets en cuir et de faux, en compagnie d’un bocal de piments. Des fils en nylon pendent d’un crochet au mur et deux pneus usagés, reliés au plafond par des chaînes métalliques, doivent servir à pendre les prisonniers par les pieds. Le seul article récent est un fer à repasser Philips, qui pour l’instant n’est pas branché. Une sale de torture faisant office de buanderie ? L’ensemble fait un peu trop déco, un peu comme un décor de théâtre abandonné. Néanmoins, en regardant mieux le plafond, je vois tout de même des éclaboussures de sang séché, et un second tour d’horizon m’avertit que l’ensemble est fonctionnel. Je me demande comment le sang a réussi à gicler si haut !
« Sous-officier, veuillez retirez votre uniforme », dit le soldat d’un ton respectueux.
Je suppose que je vais découvrir la réponse à ma dernière question. »
Du côté du dirigeant, paranoïa et bigoterie rendent le personnage éminemment grotesque. Et dangereux. Pour contrer les Soviétiques en Afghanistan, les États-Unis se sont servis des Pakistanais, chargés d’appuyer les combattants voisins. On rencontre d’ailleurs, lors d’une soirée chez l’ambassadeur, ce frimeur d’Oussama, en charge de la reconstruction.
Mais c’est le président qui fut responsable de l’islamisation de l’ennemi de l’Inde. Mohammed Hanif ne se gène pas pour dégommer le ridicule dans la religion de son pays. Témoin, cette scène d’allaitement où il nous dit que la seule chose qu’on voyait de la femme portant la burqa était son sein gauche. Un peu plus loin, c’est le brigadier chargé de la protection du président qui vire les femmes habillées ainsi : « Comment savoir si elles ne portaient pas un lance-roquettes sous cette tente ». Culs-bénis et délirant sécuritaire, un partout, la balle au centre.
A défaut de lire le dernier livre de John Le Carré, on peut suivre sa recommandation. Il a raison. Celui-ci est élégant. Et triste, horrible (la femme aveugle condamnée à la lapidation pour adultère parce qu’elle s’est fait violer mais ne peut désigner ses agresseurs), tendre et surtout drôle. Comme ce corbeau amateur de mangue.
Attentat à la mangue
10/18, domaine étranger
440 p, 8,90 €

Il n’est pas rare qu’un lecteur ait le désir de ressentir de l’empathie pour le personnage principal d’un roman. Dans le cas de « Histoire de mes assassins », cela pourrait amener à interrompre un peu rapidement le parcours de ces pages. Il semble au premier abord que Mr Sarbacane soit un connard. Sa façon de traiter sa maîtresse peut laisser circonspect. Mais peut-être faut-il essayer de le comprendre. Que peut-on ressentir quand toute la presse vous annonce que la police vient de déjouer une tentative d’assassinat sur votre personne ?
Cinq personnes ont été arrêtées. C’est leur vie que Sara, partenaire en échanges d’injures et parties de baise du journaliste miraculé, va fouiller pour savoir pourquoi ceux-là sont victimes, elle en est persuadée, d’une machination qui n’a peut-être pas grand chose à voir avec leur cible.
Tarun J Tejpal aime raconter, visiblement. Il y a des histoires dans l’histoire, coupées par des anecdotes sur des personnages tertiaires, coupées par des récits sur des figures qui s’enchaînent. C’est l’Inde. Et l’Inde est un monde. La plus grande démocratie sur Terre si l’on s’en tient aux nombres.
Si on regarde de plus près pour prendre en compte des critères comme la corruption, la justice ou la liberté de la presse, ça devient un chouïa plus complexe. On ne va pas forcément le découvrir ici, mais on en aura nettement plus qu’un aperçu. La galère du dénicheur de scandale et de Jai, son acolyte à la tête du magazine qu’ils tentent de faire survivre, est édifiante. Ils passent des mains d’un trio d’entrepreneurs bidons à celles d’un marchand d’armes.
Mais ce sont les vies des cinq assassins qui sont la chair du livre. Chair en lambeaux. Misérables, violentes, violées, tragiques, écœurantes, passionnantes, ces vies sont celles de Chaku, le couteau, dont le père et le grand-père sont militaires. Il a un oncle qui va lui donner cet outil qui fera son nom, qui fera sa vengeance, et sa fuite, et son métier. Celle de Kabir M, sans véritable patronyme, une volonté de son père pour cacher la dévotion de sa famille à la religion du prophète. Élevé dans la peur, il devient voleur et sculpteur. Infirme ne pouvant plus que pisser avec son sexe après que la police se soit occupé de lui, il trouve refuge en prison. Kaliya et Chini grandissent avec d’autres gosses abandonnés dans une gare, entre drogue (« la Solution »), larcins et viols. Hathoda Tyagi est le marteau, au sphincter d’acier, « spécialiste du curry de cervelle ».
C’est l’Inde. Avec ses Gurus que des esprits occidentaux seront prompts à ranger sous l’étiquette « ridicule », ou « folklorique ». Erreur. Avec son cinéma omniprésent dans les représentations.
L’Inde, où la plus ou moindre clarté de la peau est un critère majeur, où la plus ou moins grande utilisation dans la conversation de l’anglais ou de l’hindi est un signe de distinction fondamental.
Un monde.
Histoire de mes assassins
Le livre de Poche
600 p, 8 €
