Marre de l’esprit de Noël ? Marre du Black Friday et de sa conso qui va dans le mur ? Marre des chocolats ? Marre des joujoux en plastoc ? C’est reparti pour une nouvelle année d’une sélection bigarrée de livres en papier en forme de calendrier de l’avent bibliophile. Aujourd’hui grimpons à bord du Rebel en Alaska pour sentir le vent du nord hérissé d’embruns tranchants. C’est l’hiver, c’est le froid. C’est la mer. C’est l’ailleurs.
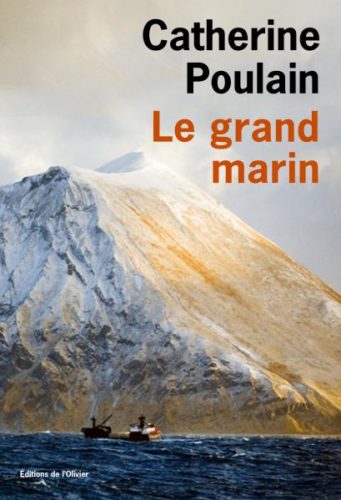 Honte sur nous, on n’a pas du tout découvert Le grand marin à sa sortie en 2016 aux Éditions de l’Olivier malgré les succès public et critique qui ont accompagné la parution du premier livre de Catherine Poulain. Mais peut-être parce que petit, ado, plus grand, on a relu en boucle ces histoires de mer, de bateau, d’attente, de marins pris par la mer, de lames qui passent par dessus la proue, de vent à en devenir fou, on a fini par glisser Le grand marin dans notre poche, comme on vous conseille de le faire sous le sapin. Une histoire de gens qui brûlent, « qui au début sont des enfants, de beaux enfants qui courent, qui courent les bois, qui courent. Puis après courent la mer, courent les bars » dira Catherine Poulain en interview.
Honte sur nous, on n’a pas du tout découvert Le grand marin à sa sortie en 2016 aux Éditions de l’Olivier malgré les succès public et critique qui ont accompagné la parution du premier livre de Catherine Poulain. Mais peut-être parce que petit, ado, plus grand, on a relu en boucle ces histoires de mer, de bateau, d’attente, de marins pris par la mer, de lames qui passent par dessus la proue, de vent à en devenir fou, on a fini par glisser Le grand marin dans notre poche, comme on vous conseille de le faire sous le sapin. Une histoire de gens qui brûlent, « qui au début sont des enfants, de beaux enfants qui courent, qui courent les bois, qui courent. Puis après courent la mer, courent les bars » dira Catherine Poulain en interview.
Lili, la menue narratrice part s’engager sur un bateau à l’autre bout du monde, The last frontier, l’Alaska, pour aller y pêcher le flétan, la morue noire. « Il faudrait toujours être en route pour l’Alaska. Mais y arriver à quoi bon. J’ai fait mon sac. C’est la nuit. Un jour je quitte Manosque-Les-Plateaux, Manosque-les-Couteaux. C’est février, les bars ne désemplissent pas, la fumée et la bière, je pars, le bout du monde, sur la Grande Bleue, vers le cristal et le péril, je pars. Je ne veux plus mourir d’ennui, de bière, d’une balle perdue. De malheur. Je pars. » Lily ne dit pas ce qu’elle fuit. Mais elle part loin devant. Brise ses amarres.

Un sac de l’armée brodé et couvert d’étoffes précieuses pour tout bagage, tassée sur le siège d’un greyhound, elle quitte New York avec un anorak bleu ciel sur le dos qui se déplume en nuages jusqu’à son arrivée dans l’état de Washington. « Je retrouve un ami pêcheur à Seattle. Il m’amène sur son bateau. Depuis des années il m’attend. Ma photo est sur les murs. Le voilier porte mon nom. Plus tard il pleure. (…) Lentement, je remplis mon sac. Il me dit de rester pourtant, de rester cette nuit encore. » Mais l’appel de l’Alaska est le plus fort. « Mon bateau partira pour l’Amérique Et je ne reviendrai jamais » chantait l’Emigrant de Landor Road et Lily pourrait lui donner la réplique. Alors bien sûr l’arrivée sur l’île de Kodiak ne va pas sans l’angoisse qui fait une boule dans le ventre au milieu « des forêts sombres, des montagnes et puis la terre brune et sale qui paraît sous la neige fondue » mais Lily, toute menue et inexpérimentée qu’elle soit est bigrement obstinée. Et toute la douceur humble et têtue dont elle fait preuve finit par payer.

On lui propose deux places de matelot le même jour : pêche au hareng le long des côtes, ou embarquer sur un palangrier pour aller chercher la morue noire, au large. « Je choisis le deuxième parce que cela sonne plus beau, long-lining, que cela va être dur et dangereux, que l’équipage sera composé de matelots endurcis. » Dont Jude, le grand marin aux mains solides, l’homme-lion taiseux qui se cache, solitaire qui brûle de l’intérieur. Lily n’est pas venue en Alaska pour la facilité. « Il va falloir faire tes preuves dès maintenant » avertit le capitaine. Ça tombe bien, Lily est là pour ça. Pour s’éprouver. Pour trouver une unité. Pour arrêter de s’entendre. Il s’agit de « se battre contre ses propres démons, se battre contre ses propres limites, contre ce petit corps qui toujours, gêne. Qui toujours gémit, qui toujours est fatigué. Ne pas s’avouer qu’on a mal, (…) y aller, ça fait partie de l’apprentissage. Aller toujours au-delà, arriver à trouver sa place, s’intégrer et passer toutes les épreuves » explique Catherine Poulain à Laure Adler.

Elle commence par préparer le bateau avec les autres. Pendant trois semaines. Et c’est déjà un nouveau monde qu’on découvre avec elle. Les filets, les nœuds, les anpecs. Les pins noirs qui geignent dans la nuit. Les hommes durs en dehors, bouleversés du dedans, ces hommes qui brûlent et aiment à peindre la ville en rouge. L’expression que Lily, la petite émigrée française ne comprend d’abord pas. Se cuiter. Passer de l’excès de travail, de la « volupté de l’exténuement » à ce grand vide à terre qu’on remplit par l’excès d’alcool, jusqu’à en tomber raide au sol, à se faire sortir des bars traîné par les pieds.
L’Alaska est un double désert, celui de l’océan bien sûr, mais celui de la Terre, aussi, aride, âpre. Une terre rejointe par des âmes cabossées, les vétérans de la guerre du Vietnam, des native-americans cramés par l’alcool et la pauvreté, ceux qui ont vécu des drames dont on ne se relève pas, qu’ils soient familiaux, sociaux, sanglants. Tout ce dont on ne parle pas. Ceux qui fuient. Ceux qui cherchent. Qui sont parfois les mêmes. Alors en Alaska, il y a le silence. Le silence fraternel. Entre les écorchés, les démolis, les ravinés. Le silence qui protège. Personne ne demande rien. Tout le monde est dans l’immédiat. Le juste après. La prochaine pêche. La prochaine cuite.

Tout brûle. Constamment. « Je ne sais pas ce qui fait qu’on veuille tant souffrir, pour rien au fond. Manquer de tout, de sommeil, de chaleur, d’amour aussi, jusqu’à haïr le métier, et que malgré tout on en redemande, parce que le reste du monde vous semble fade, vous ennuie à en devenir fou. Qu’on finit par ne plus pouvoir se passer de ça, de cette ivresse, de ce danger, de cette folie » avoue Adam le matelot du Blue Beauty. Car sur le huis-clos du bateau, une fois larguées les amarres c’est un rythme harassant qui concasse les corps et les âmes. Avant de partir, Lily demande à quoi elle doit faire attention. « A tout, aux lignes qui s’en vont dans l’eau avec une force qui t’emporterait si tu te prends le pied, le bras dedans, à celles que l’on ramène qui, si elles se brisent peuvent te tuer, te défigurer… Aux hameçons qui se coincent dans le vireur et sont projetés n’importe où, au gros temps, au récif que l’on n’a pas calculé, à celui qui s’endort pendant son quart, à la chute à la mer, la vague qui t’embraque et le froid qui te tue… » ou la coupure d’un idiot fish, le poisson aux nageoires empoisonnées, qui s’infecte et dégénère en septicémie, dont la trace remonte le long du bras de Lily. « Risquer de perdre la vie mais au moins la trouver avant » c’est pour ça que Lily est là.

Il y a les pêches pour rien, celles où les palangres vides blessent les cœurs et les corps. Celles ou même les palangres restent par le fond sous les regards livides des marins. Et puis les pêches sans discontinuer, les journées de travail de plus de vingt heures, le sommeil épisodique, les corps brisés au delà de l’effort physique, le froid tout le temps, les bottes qui prennent l’eau, la vapeur d’eau qui glace sur les visages, le sang des flétans que l’on vide partout sur les cirés, le pont, les mèches qui collent sous le bonnet. Les quarts où il faut lutter contre le sommeil pour surveiller les écueils, les glaces. Les cris des hommes dans le vacarme assourdissant des machines, des poulies qui broient, déchiquètent et le roulis continuel, les lames, les tempêtes. On est au cœur de l’océan, de son râle. Lily la bleue, la green en anglais, se fait houspiller constamment, travaille comme une forcenée, des fois la rage au ventre et les yeux humides, se fait voler sa couchette, dort à même le sol de la timonerie. Mais toute ballotée et fragile qu’elle soit, elle a la force de ceux qui tiennent.

Catherine Poulain parvient à nous plonger en immersion dans ce monde âpre et dur, à nous faire sentir ces hommes consummés d’alcool et de sel, leur solidité et leur fragilité. Comme eux, on perd toute notion du jour, de la nuit. Seule compte la rapidité avec laquelle sont vidés les flétans, remontées les palangres. Le vent polaire sur le visage, les embruns qui se transforment en seaux balancés et ruisselants sur les cirés oranges. Dans la brume, dans l’obscurité la plus totale. Le café fumant qu’on n’arrive pas à tenir tant la tempête roule en vagues terribles. On y est. Et on ne veut plus en sortir. « C’est la nuit sur l’Alaska et moi dedans je pense, avec le vent, avec les oiseaux dans les arbres, oh faites que cela dure, faites que l’Immigration ne m’attrape jamais. » Dans la vraie vie l’Immigration retrouvera Catherine Poulain qui à Lily donne tant de son passé. Et quand l’autrice explique à Laure Adler dans Hors Champs : « J’ai été interdite de séjour pendant longtemps aux États-Unis, parce que j’avais été illégale. 10 ans d’interdiction. (…) Ça fait trois ans que j’aurais pu y retourner. Mais c’était très difficile d’imaginer de pouvoir y retourner en touriste. C’était même insupportable comme idée. Je n’aurais que le droit d’être au bar, voir les bateaux partir et rentrer. Et ça c’est impossible » on la comprend désormais tant cette lettre d’amour à la mer, à ces hommes, aussi sensible que viscérale, remue de l’intérieur. Et donne envie de cet ailleurs.

Le grand marin de Catherine Poulain, Éditions de L’olivier (2016).
